1 - Les scénarios des mondes parallèles.
D'autres univers parallèles au nôtre existent ! C'est ce qui découle de différentes théories, plus ou moins spéculatives, qui décrivent le cosmos. En réalité, il n'existe pas un seul type d'univers multiples.
J uste un parmi tant d'autres ! Notre Univers, pourtant immense, ne serait qu'une infime partie d'une structure cosmique bien plus vaste, un simple échantillon d'une multitude de mondes. La littérature et le cinéma n'ont cessé d'explorer cette idée. Et pas seulement la science-fiction. Par exemple, dans le film en deux volets Smoking/No smoking du réalisateur français Alain Resnais, le début de l'histoire repose sur la décision de l'un des personnages de fumer ou pas. Chaque volet du film propose ensuite six fins possibles à chacun de ces débuts. Douze scénarios dans douze univers différents, tous aussi réels les uns que les autres !
La notion d'univers multiples pousse cette idée à l'infini : tous les scénarios ont lieu. Celui d'un monde doté de galaxies, d'étoiles et d'une Terre, dans lequel vous commencez à lire cet article. Celui du même monde, dans lequel vous avez déjà fini votre lecture. Mais aussi celui d'un monde sans étoile, ni planète, ni lecteur. Et une infinité d'autres encore.
La proposition est vertigineuse, mais est-elle scientifique ? L'idée d'une multitude de mondes n'est pas nouvelle (lire « Les univers multiples au fil du temps » , ci-contre). Anaximandre de Milet, penseur grec, la défendait déjà il y a vingt-six siècles. Elle a même valu le bûcher à Rome, en 1600, au philosophe italien Giordano Bruno, qui avec ses « infinités de mondes » bousculait une vision du monde centrée sur notre Terre. Mais il y a encore seulement trente ans, les théories décrivant d'autres univers que le nôtre étaient considérées comme de la métaphysique.
Or aujourd'hui, bien que l'hypothèse demeure spéculative et controversée, elle a gagné le champ scientifique. Elle paraît même très stimulante, à en croire le nombre de scientifiques de renom qui s'y intéressent (lire « Réactions à l'hypothèse des multivers », p. 43). L'ouvrage qui fait référence sur le sujet Universe or Multiverse, publié sous la direction du cosmologiste Bernard Carr de l'université Queen Mary à Londres, en témoigne [1] . Tout autant que les colloques autour de cette question qui se multiplient [2] .
Outil de travail.
Ces dernières années, ils sont même devenus pour certains physiciens théoriciens, comme Thibault Damour de l'Institut des hautes études scientifiques, « un outil de travail dont on ne peut plus faire l'économie » . D'autres s'y opposent fortement, considérant que l'hypothèse ne peut de toute manière être testée, à l'instar du Prix Nobel de physique 2004, David Gross.
Toujours est-il que différentes théories, en cherchant à décrire l'Univers et les forces qui le gouvernent, conduisent à l'existence d'univers multiples. Ils ne sont donc pas tous de même nature. Et les visions diffèrent sur la manière dont émergent ces univers multiples.
Le multivers, appellation choisie par opposition à univers, recouvre donc en réalité différents types de multimondes. Ce qui entretient parfois une certaine confusion, reconnaît Max Tegmark, du Massachusetts Institute of Technology, qui a proposé une classification des multivers pour clarifier les choses [3] . Nous retiendrons les quatre catégories les plus souvent évoquées (lire « Quatre formes de multivers », p. 44)
Le plus élémentaire.
Le premier type, le plus élémentaire, découle directement de l'application de la relativité générale d'Einstein au cosmos. L'Univers désigne tout ce qui nous entoure. Mais, la vitesse de la lumière étant finie, notre capacité d'observation est limitée. Seul un certain volume nous est accessible. Dans le modèle du Big Bang, en tenant compte de la distance parcourue depuis 13,7 milliards d'années pendant que l'Univers s'agrandissait, ce volume correspond actuellement à une sphère centrée sur la Terre et dont le rayon est d'environ 46 milliards d'années-lumière [fig. 1] . Or, la relativité générale nous dit aussi qu'au-delà de cet horizon un espace infini peut exister. En tout cas, dans la configuration d'un espace à courbure nulle, qui est la géométrie la plus simple en accord avec les observations, actuellement.
Le multivers dans ce cas désigne l'ensemble de cet espace infini où les zones situées au-delà du volume qui nous est accessible abritent de nouveaux univers : d'autres volumes de même format, juxtaposés les uns aux autres. Suivant cette vision, nous humains, nous trouvons simplement dans une partie du multivers où sont réunies les conditions très particulières nécessaires au long processus qui conduit à l'émergence de la vie. Dans ce multivers élémentaire, les lois de la physique sont les mêmes d'une sphère à l'autre, mais les conditions y diffèrent selon la manière dont les mécanismes à l'oeuvre lors du Big Bang ont réparti la matière. Selon Max Tegmark, des univers jumeaux, copies à l'identique, peuvent exister, mais pas à moins de (1010)115 mètres l'un de l'autre. Peu de chances donc de rencontrer son double. Le premier des multivers consiste donc en une simple juxtaposition d'univers.
La deuxième catégorie est plus complexe. Elle émane du modèle cosmologique le plus en vogue aujourd'hui pour décrire l'évolution du tout jeune Univers, l'inflation cosmique.
L'inflation éternelle.
C'est dans les années 1980 que le cosmologiste d'origine russe Andrei Linde, aujourd'hui à l'université Stanford, a développé un modèle détaillé d'inflation [4] . Selon cette théorie, notre Univers a connu une gigantesque phase d'expansion, juste après le Big Bang : à 10-35 seconde, la taille du tout jeune Univers extrêmement chaud et dense aurait brusquement été multipliée par un facteur 1050. Cette accélération démesurée permet d'expliquer pourquoi l'Univers est si homogène à grande échelle et également de rendre compte de l'apparition des grandes structures cosmologiques, comme les amas de galaxies, telles qu'elles sont aujourd'hui observées. Mais la théorie de Linde va encore plus loin : elle suppose que l'espace-temps est en perpétuelle inflation. C'est l'inflation éternelle. Plus précisément, certaines régions continuent à connaître une phase d'inflation conduisant à autant de bulles distinctes et donnant lieu à une infinité de big bang. Chaque big bang crée un univers. L'hypothèse est très spéculative. Mais il s'agit là d'un multivers bien plus divers que le précédent.
Depuis quelques années, ce « multivers-bulle » s'est vu renforcé par le développement de la théorie des cordes, qui cherche, elle, à décrire toutes les interactions fondamentales de la physique : électromagnétisme, forces nucléaires et, surtout, gravitation. Cette théorie en quête d'unification des lois de la nature, où toutes les particules apparaissent comme des modes de vibration d'une corde élémentaire, à l'instar d'une corde de violon qui peut générer toutes les notes de la gamme, est encore loin d'avoir atteint son but. Pour l'instant, au lieu de mener à une seule théorie, elle a conduit à 10500, voire 101000, théories différentes !
Ainsi lorsque l'inflation éternelle est pensée dans le cadre de la théorie des cordes, la diversité du multivers-bulle explose. C'est cette version que défend Léonard Susskind, l'un des pères de la théorie des cordes, lui aussi professeur à Stanford [5] . Ce multivers est une structure gigogne composée d'une infinité d'univers-bulles, dotés chacun de ses propres lois de la physique, et abritant chacun une infinité d'univers élémentaires. Là encore, dans cet insondable paysage, nous nous trouverions simplement dans un îlot, particulièrement bien adapté à la vie.
La gravitation quantique à boucles.
Mais ce type de multivers est très critiqué par Lee Smolin, du Perimeter institute au Canada. Celui-ci est connu pour sa sévérité à l'égard la prédominance de la théorie des cordes en physique théorique [6] . Selon lui, aucune prédiction ne permet de le tester, et il échappe à toute expérience possible, le niveau des énergies en jeu dans ces phénomènes étant tout simplement hors de notre portée. Pour autant, sa propre théorie l'a amené à proposer une tout autre approche en 1992 : l'hypothèse de la « sélection naturelle cosmologique », qui conduit à un troisième type d'univers multiple [7].
Lee Smolin est l'un des inventeurs de la « gravité quantique à boucles », théorie quantique de la gravitation. Or cette théorie ne prédit pas de singularité centrale des trous noirs, ce lieu où la densité et la courbure de l'espace-temps deviennent infinies. Dans ce cas, très proche du centre, la gravité devient répulsive. Tout se passe comme si la matière se contracte vers le centre pour rebondir ensuite à ces abords dans une nouvelle phase d'expansion. Un nouvel univers en expansion naîtrait ainsi à l'intérieur même du trou noir. Et chaque trou noir formé engendrerait lui-même un univers. Notre monde aurait ainsi au moins 1018 enfants-univers créés par ses trous noirs.
Dans ce multivers imbriqué, très inspiré de l'évolution darwinienne biologique, chaque univers transmet à sa descendance ses propres lois de la physique, légèrement modifiées par les fluctuations quantiques au moment du « rebond » dans le trou noir, évitant ainsi une simple réplication à l'identique. Un tel mécanisme évolutif favoriserait les lois qui maximisent la production de trous noirs, c'est-à-dire la procréation. Séduisant, ce modèle n'en demeure pas moins embryonnaire. Il reste en particulier à préciser le mécanisme de la transmission des lois de la physique. Mais, d'après son auteur, il a le mérite d'établir des prédictions testables. Il fixe, entre autres, la masse limite supérieure d'une étoile à neutrons, étape intermédiaire entre l'explosion de supernova d'une étoile massive et la formation d'un trou noir, autour de 1,6 masse solaire.
Tous les mondes existent.
Enfin, la dernière catégorie d'univers parallèles nous vient d'un tout autre horizon. Les précédents découlaient tous de théories décrivant la gravitation, force à l'oeuvre aux plus grandes échelles de l'Univers. Celui-ci nous vient de la mécanique quantique, cadre théorique qui explique le monde de l'infiniment petit. Longtemps considéré comme farfelu, c'est en fait le premier multivers scientifique d'un point de vue historique [8] . En 1957, le physicien américain Hugh Everett, alors à Princeton, propose une interprétation iconoclaste de la théorie quantique. Il pousse jusqu'au bout le principe de superposition des états de la matière que requiert cette théorie. Selon ce principe, un système quantique peut être dans plusieurs états à la fois. Les mesures de ce système peuvent conduire à des résultats différents. Pour Everett, ce principe n'est pas seulement vrai à l'échelle microscopique, il l'est aussi à l'échelle macroscopique. Les différents résultats de mesure possibles coexistent comme autant de réalités parallèles : tous les mondes existent ! Celui où l'on fume et celui où l'on ne fume pas. Et ils se ramifient sans cesse en de nouveaux mondes. Pourquoi n'en observons-nous alors qu'un seul ? Simplement parce que nous ne pouvons voir que celui dans lequel nous nous trouvons.
Aussi étonnante soit-elle, l'interprétation d'Everett est aujourd'hui considérée de plus en plus sérieusement par certains physiciens. Pour Thibault Damour : « C'est même celle qui s'impose désormais . » Et dans la classification du cosmologiste Max Tegmark, les univers d'Everett se placent au même niveau que le multivers-bulle inflationnaire. Ils ajoutent, selon lui, simplement davantage encore de copies impossibles à distinguer. Ce qui paraissait purement métaphysique, il y a peu, semble donc gagner ses lettres de noblesse scientifiques.
PAR Hélène Le Meur
Les univers multiples au fil du temps
> Première cosmologie non mythologique : des mondes apparaissent quand d'autres disparaissent Anaximandre, penseur grec, 610-546 av. J.-C.
> Les atomes et les mondes sont en nombre illimité
Démocrite, philosophe grec, 460-370 av. J.-C. > Pluralité des mondes dont les habitants se distingueraient par leur caractère propre
Nicolas de Cues, penseur allemand, 1401-1465.
> Des mondes infinis distincts les uns des autres
Giordano Bruno, philosophe italien, 1548-1600.
> Il existe plusieurs mondes et, selon le cycle du temps, il tombe des vérités dans les mondes disposés suivant une structure triangulaire autour des idées platoniciennes
François Rabelais, humaniste français (vers 1490-1553).
> Multitude de mondes possibles parmi lesquels notre Univers est le meilleur
Gottfried Wilhelm Leibniz, philosophe et mathématicien allemand, 1646-1716 .
> Conversations galantes à propos de la pluralité des mondes
Bernard le Bouyer de Fontenelle, philosophe français, 1657-1757.
> Mondes multiples réels et coexistants, créés par l'usage de symboles
Nelson Goodman, philosophe américain, 1906-1998.
> Tout ce qui aurait pu se produire dans notre monde se produit réellement dans un autre monde
David Lewis, philosophe analytique américain, 1941-2001.
> Les mondes parallèles entrent dans le champ des sciences dures via la mécanique quantique
Hugh Everett, mathématicien américain, 1930-1982.
> Première introduction de multivers dans le domaine de la cosmologie avec le scénario d'inflation éternelle
Andrei Linde, physicien américain d'origine russe, né en 1948.
L'essentiel
DIFFÉRENTES THÉORIES cherchant à décrire l'Univers et les forces qui le gouvernent conduisent à l'hypothèse des univers multiples.
LE MULTIVERS a gagné le champ de la science, et de nombreux scientifiques de renom s'y intéressent. Mais les visions diffèrent sur la manière dont émergent ces mondes parallèles.
QUATRE TYPES de multivers sont souvent évoqués, du plus élémentaire issu de la théorie de la relativité générale à celui résultant de la mécanique quantique.
Réactions à l'hypothèse des multivers
Outre les personnalités déjà citées dans l'article ci-contre, nombre d'autres scientifiques de renom se positionnent par rapport à la notion de multivers. Voici quelques exemples.
> POUR Au premier rang des pro-multivers, Steven Weinberg, Prix Nobel et fondateur du Modèle standard de la physique des particules, pense qu'il s'agit d'un changement important dans la nature même de la science. « Il faut apprendre à vivre dans un multivers », affirme-t-il. On peut citer également les Britanniques Martin Rees, astronome royal, Stephen Hawking, mathématicien et physicien de l'université de Cambridge, ou encore le théoricien des cordes de Princeton et Médaille Fields, Edward Witten.
> CONTRE D'autres y sont totalement opposés. David Gross, par exemple, autre théoricien américain et Prix Nobel 2004, réfute la validité de paysage de mondes multiples. Il pense résolument que l'on devrait trouver une théorie du tout capable d'expliquer l'Univers dans lequel nous sommes en termes de lois mathématiques bien définies. Paul Steinhardt, théoricien de l'inflation, à Princeton, déteste quant à lui le concept : « C'est une idée dangereuse, que je ne veux tout simplement pas envisager . »
> SCEPTIQUES Entre ces deux positions, George Ellis, cosmologiste à l'université du Cap, en Afrique du Sud, trouve l'hypothèse des multivers intéressante en ce qu'elle apporte des explications à certaines observations, mais les arguments en faveur de leur existence restent à ses yeux de nature philosophique. Et il ne veut pas brouiller les frontières. Autre réserve, celle de Paul Davies, de l'université de l'Arizona, qui se dit modérément sceptique. Il trouve aussi l'hypothèse stimulante, mais selon lui, elle exige finalement d'accepter, sans autre explication, tout un jeu de lois spéculatives.
Source: http://www.larecherche.fr/content/recherche/article?id=26210
D'autres univers parallèles au nôtre existent ! C'est ce qui découle de différentes théories, plus ou moins spéculatives, qui décrivent le cosmos. En réalité, il n'existe pas un seul type d'univers multiples.
J uste un parmi tant d'autres ! Notre Univers, pourtant immense, ne serait qu'une infime partie d'une structure cosmique bien plus vaste, un simple échantillon d'une multitude de mondes. La littérature et le cinéma n'ont cessé d'explorer cette idée. Et pas seulement la science-fiction. Par exemple, dans le film en deux volets Smoking/No smoking du réalisateur français Alain Resnais, le début de l'histoire repose sur la décision de l'un des personnages de fumer ou pas. Chaque volet du film propose ensuite six fins possibles à chacun de ces débuts. Douze scénarios dans douze univers différents, tous aussi réels les uns que les autres !
La notion d'univers multiples pousse cette idée à l'infini : tous les scénarios ont lieu. Celui d'un monde doté de galaxies, d'étoiles et d'une Terre, dans lequel vous commencez à lire cet article. Celui du même monde, dans lequel vous avez déjà fini votre lecture. Mais aussi celui d'un monde sans étoile, ni planète, ni lecteur. Et une infinité d'autres encore.
La proposition est vertigineuse, mais est-elle scientifique ? L'idée d'une multitude de mondes n'est pas nouvelle (lire « Les univers multiples au fil du temps » , ci-contre). Anaximandre de Milet, penseur grec, la défendait déjà il y a vingt-six siècles. Elle a même valu le bûcher à Rome, en 1600, au philosophe italien Giordano Bruno, qui avec ses « infinités de mondes » bousculait une vision du monde centrée sur notre Terre. Mais il y a encore seulement trente ans, les théories décrivant d'autres univers que le nôtre étaient considérées comme de la métaphysique.
Or aujourd'hui, bien que l'hypothèse demeure spéculative et controversée, elle a gagné le champ scientifique. Elle paraît même très stimulante, à en croire le nombre de scientifiques de renom qui s'y intéressent (lire « Réactions à l'hypothèse des multivers », p. 43). L'ouvrage qui fait référence sur le sujet Universe or Multiverse, publié sous la direction du cosmologiste Bernard Carr de l'université Queen Mary à Londres, en témoigne [1] . Tout autant que les colloques autour de cette question qui se multiplient [2] .
Outil de travail.
Ces dernières années, ils sont même devenus pour certains physiciens théoriciens, comme Thibault Damour de l'Institut des hautes études scientifiques, « un outil de travail dont on ne peut plus faire l'économie » . D'autres s'y opposent fortement, considérant que l'hypothèse ne peut de toute manière être testée, à l'instar du Prix Nobel de physique 2004, David Gross.
Toujours est-il que différentes théories, en cherchant à décrire l'Univers et les forces qui le gouvernent, conduisent à l'existence d'univers multiples. Ils ne sont donc pas tous de même nature. Et les visions diffèrent sur la manière dont émergent ces univers multiples.
Le multivers, appellation choisie par opposition à univers, recouvre donc en réalité différents types de multimondes. Ce qui entretient parfois une certaine confusion, reconnaît Max Tegmark, du Massachusetts Institute of Technology, qui a proposé une classification des multivers pour clarifier les choses [3] . Nous retiendrons les quatre catégories les plus souvent évoquées (lire « Quatre formes de multivers », p. 44)
Le plus élémentaire.
Le premier type, le plus élémentaire, découle directement de l'application de la relativité générale d'Einstein au cosmos. L'Univers désigne tout ce qui nous entoure. Mais, la vitesse de la lumière étant finie, notre capacité d'observation est limitée. Seul un certain volume nous est accessible. Dans le modèle du Big Bang, en tenant compte de la distance parcourue depuis 13,7 milliards d'années pendant que l'Univers s'agrandissait, ce volume correspond actuellement à une sphère centrée sur la Terre et dont le rayon est d'environ 46 milliards d'années-lumière [fig. 1] . Or, la relativité générale nous dit aussi qu'au-delà de cet horizon un espace infini peut exister. En tout cas, dans la configuration d'un espace à courbure nulle, qui est la géométrie la plus simple en accord avec les observations, actuellement.
Le multivers dans ce cas désigne l'ensemble de cet espace infini où les zones situées au-delà du volume qui nous est accessible abritent de nouveaux univers : d'autres volumes de même format, juxtaposés les uns aux autres. Suivant cette vision, nous humains, nous trouvons simplement dans une partie du multivers où sont réunies les conditions très particulières nécessaires au long processus qui conduit à l'émergence de la vie. Dans ce multivers élémentaire, les lois de la physique sont les mêmes d'une sphère à l'autre, mais les conditions y diffèrent selon la manière dont les mécanismes à l'oeuvre lors du Big Bang ont réparti la matière. Selon Max Tegmark, des univers jumeaux, copies à l'identique, peuvent exister, mais pas à moins de (1010)115 mètres l'un de l'autre. Peu de chances donc de rencontrer son double. Le premier des multivers consiste donc en une simple juxtaposition d'univers.
La deuxième catégorie est plus complexe. Elle émane du modèle cosmologique le plus en vogue aujourd'hui pour décrire l'évolution du tout jeune Univers, l'inflation cosmique.
L'inflation éternelle.
C'est dans les années 1980 que le cosmologiste d'origine russe Andrei Linde, aujourd'hui à l'université Stanford, a développé un modèle détaillé d'inflation [4] . Selon cette théorie, notre Univers a connu une gigantesque phase d'expansion, juste après le Big Bang : à 10-35 seconde, la taille du tout jeune Univers extrêmement chaud et dense aurait brusquement été multipliée par un facteur 1050. Cette accélération démesurée permet d'expliquer pourquoi l'Univers est si homogène à grande échelle et également de rendre compte de l'apparition des grandes structures cosmologiques, comme les amas de galaxies, telles qu'elles sont aujourd'hui observées. Mais la théorie de Linde va encore plus loin : elle suppose que l'espace-temps est en perpétuelle inflation. C'est l'inflation éternelle. Plus précisément, certaines régions continuent à connaître une phase d'inflation conduisant à autant de bulles distinctes et donnant lieu à une infinité de big bang. Chaque big bang crée un univers. L'hypothèse est très spéculative. Mais il s'agit là d'un multivers bien plus divers que le précédent.
Depuis quelques années, ce « multivers-bulle » s'est vu renforcé par le développement de la théorie des cordes, qui cherche, elle, à décrire toutes les interactions fondamentales de la physique : électromagnétisme, forces nucléaires et, surtout, gravitation. Cette théorie en quête d'unification des lois de la nature, où toutes les particules apparaissent comme des modes de vibration d'une corde élémentaire, à l'instar d'une corde de violon qui peut générer toutes les notes de la gamme, est encore loin d'avoir atteint son but. Pour l'instant, au lieu de mener à une seule théorie, elle a conduit à 10500, voire 101000, théories différentes !
Ainsi lorsque l'inflation éternelle est pensée dans le cadre de la théorie des cordes, la diversité du multivers-bulle explose. C'est cette version que défend Léonard Susskind, l'un des pères de la théorie des cordes, lui aussi professeur à Stanford [5] . Ce multivers est une structure gigogne composée d'une infinité d'univers-bulles, dotés chacun de ses propres lois de la physique, et abritant chacun une infinité d'univers élémentaires. Là encore, dans cet insondable paysage, nous nous trouverions simplement dans un îlot, particulièrement bien adapté à la vie.
La gravitation quantique à boucles.
Mais ce type de multivers est très critiqué par Lee Smolin, du Perimeter institute au Canada. Celui-ci est connu pour sa sévérité à l'égard la prédominance de la théorie des cordes en physique théorique [6] . Selon lui, aucune prédiction ne permet de le tester, et il échappe à toute expérience possible, le niveau des énergies en jeu dans ces phénomènes étant tout simplement hors de notre portée. Pour autant, sa propre théorie l'a amené à proposer une tout autre approche en 1992 : l'hypothèse de la « sélection naturelle cosmologique », qui conduit à un troisième type d'univers multiple [7].
Lee Smolin est l'un des inventeurs de la « gravité quantique à boucles », théorie quantique de la gravitation. Or cette théorie ne prédit pas de singularité centrale des trous noirs, ce lieu où la densité et la courbure de l'espace-temps deviennent infinies. Dans ce cas, très proche du centre, la gravité devient répulsive. Tout se passe comme si la matière se contracte vers le centre pour rebondir ensuite à ces abords dans une nouvelle phase d'expansion. Un nouvel univers en expansion naîtrait ainsi à l'intérieur même du trou noir. Et chaque trou noir formé engendrerait lui-même un univers. Notre monde aurait ainsi au moins 1018 enfants-univers créés par ses trous noirs.
Dans ce multivers imbriqué, très inspiré de l'évolution darwinienne biologique, chaque univers transmet à sa descendance ses propres lois de la physique, légèrement modifiées par les fluctuations quantiques au moment du « rebond » dans le trou noir, évitant ainsi une simple réplication à l'identique. Un tel mécanisme évolutif favoriserait les lois qui maximisent la production de trous noirs, c'est-à-dire la procréation. Séduisant, ce modèle n'en demeure pas moins embryonnaire. Il reste en particulier à préciser le mécanisme de la transmission des lois de la physique. Mais, d'après son auteur, il a le mérite d'établir des prédictions testables. Il fixe, entre autres, la masse limite supérieure d'une étoile à neutrons, étape intermédiaire entre l'explosion de supernova d'une étoile massive et la formation d'un trou noir, autour de 1,6 masse solaire.
Tous les mondes existent.
Enfin, la dernière catégorie d'univers parallèles nous vient d'un tout autre horizon. Les précédents découlaient tous de théories décrivant la gravitation, force à l'oeuvre aux plus grandes échelles de l'Univers. Celui-ci nous vient de la mécanique quantique, cadre théorique qui explique le monde de l'infiniment petit. Longtemps considéré comme farfelu, c'est en fait le premier multivers scientifique d'un point de vue historique [8] . En 1957, le physicien américain Hugh Everett, alors à Princeton, propose une interprétation iconoclaste de la théorie quantique. Il pousse jusqu'au bout le principe de superposition des états de la matière que requiert cette théorie. Selon ce principe, un système quantique peut être dans plusieurs états à la fois. Les mesures de ce système peuvent conduire à des résultats différents. Pour Everett, ce principe n'est pas seulement vrai à l'échelle microscopique, il l'est aussi à l'échelle macroscopique. Les différents résultats de mesure possibles coexistent comme autant de réalités parallèles : tous les mondes existent ! Celui où l'on fume et celui où l'on ne fume pas. Et ils se ramifient sans cesse en de nouveaux mondes. Pourquoi n'en observons-nous alors qu'un seul ? Simplement parce que nous ne pouvons voir que celui dans lequel nous nous trouvons.
Aussi étonnante soit-elle, l'interprétation d'Everett est aujourd'hui considérée de plus en plus sérieusement par certains physiciens. Pour Thibault Damour : « C'est même celle qui s'impose désormais . » Et dans la classification du cosmologiste Max Tegmark, les univers d'Everett se placent au même niveau que le multivers-bulle inflationnaire. Ils ajoutent, selon lui, simplement davantage encore de copies impossibles à distinguer. Ce qui paraissait purement métaphysique, il y a peu, semble donc gagner ses lettres de noblesse scientifiques.
PAR Hélène Le Meur
Les univers multiples au fil du temps
> Première cosmologie non mythologique : des mondes apparaissent quand d'autres disparaissent Anaximandre, penseur grec, 610-546 av. J.-C.
> Les atomes et les mondes sont en nombre illimité
Démocrite, philosophe grec, 460-370 av. J.-C. > Pluralité des mondes dont les habitants se distingueraient par leur caractère propre
Nicolas de Cues, penseur allemand, 1401-1465.
> Des mondes infinis distincts les uns des autres
Giordano Bruno, philosophe italien, 1548-1600.
> Il existe plusieurs mondes et, selon le cycle du temps, il tombe des vérités dans les mondes disposés suivant une structure triangulaire autour des idées platoniciennes
François Rabelais, humaniste français (vers 1490-1553).
> Multitude de mondes possibles parmi lesquels notre Univers est le meilleur
Gottfried Wilhelm Leibniz, philosophe et mathématicien allemand, 1646-1716 .
> Conversations galantes à propos de la pluralité des mondes
Bernard le Bouyer de Fontenelle, philosophe français, 1657-1757.
> Mondes multiples réels et coexistants, créés par l'usage de symboles
Nelson Goodman, philosophe américain, 1906-1998.
> Tout ce qui aurait pu se produire dans notre monde se produit réellement dans un autre monde
David Lewis, philosophe analytique américain, 1941-2001.
> Les mondes parallèles entrent dans le champ des sciences dures via la mécanique quantique
Hugh Everett, mathématicien américain, 1930-1982.
> Première introduction de multivers dans le domaine de la cosmologie avec le scénario d'inflation éternelle
Andrei Linde, physicien américain d'origine russe, né en 1948.
L'essentiel
DIFFÉRENTES THÉORIES cherchant à décrire l'Univers et les forces qui le gouvernent conduisent à l'hypothèse des univers multiples.
LE MULTIVERS a gagné le champ de la science, et de nombreux scientifiques de renom s'y intéressent. Mais les visions diffèrent sur la manière dont émergent ces mondes parallèles.
QUATRE TYPES de multivers sont souvent évoqués, du plus élémentaire issu de la théorie de la relativité générale à celui résultant de la mécanique quantique.
Réactions à l'hypothèse des multivers
Outre les personnalités déjà citées dans l'article ci-contre, nombre d'autres scientifiques de renom se positionnent par rapport à la notion de multivers. Voici quelques exemples.
> POUR Au premier rang des pro-multivers, Steven Weinberg, Prix Nobel et fondateur du Modèle standard de la physique des particules, pense qu'il s'agit d'un changement important dans la nature même de la science. « Il faut apprendre à vivre dans un multivers », affirme-t-il. On peut citer également les Britanniques Martin Rees, astronome royal, Stephen Hawking, mathématicien et physicien de l'université de Cambridge, ou encore le théoricien des cordes de Princeton et Médaille Fields, Edward Witten.
> CONTRE D'autres y sont totalement opposés. David Gross, par exemple, autre théoricien américain et Prix Nobel 2004, réfute la validité de paysage de mondes multiples. Il pense résolument que l'on devrait trouver une théorie du tout capable d'expliquer l'Univers dans lequel nous sommes en termes de lois mathématiques bien définies. Paul Steinhardt, théoricien de l'inflation, à Princeton, déteste quant à lui le concept : « C'est une idée dangereuse, que je ne veux tout simplement pas envisager . »
> SCEPTIQUES Entre ces deux positions, George Ellis, cosmologiste à l'université du Cap, en Afrique du Sud, trouve l'hypothèse des multivers intéressante en ce qu'elle apporte des explications à certaines observations, mais les arguments en faveur de leur existence restent à ses yeux de nature philosophique. Et il ne veut pas brouiller les frontières. Autre réserve, celle de Paul Davies, de l'université de l'Arizona, qui se dit modérément sceptique. Il trouve aussi l'hypothèse stimulante, mais selon lui, elle exige finalement d'accepter, sans autre explication, tout un jeu de lois spéculatives.
Source: http://www.larecherche.fr/content/recherche/article?id=26210





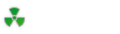







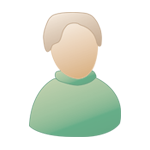


» Il signale un OVNI et disparaît en plein vol : enquête sur la disparition inexplicable de ce pilote
» Mont-Saint-Michel - Le labyrinthe de l’archange | ARTE
» L'ISS en 1914 ?
» Le cas Alain Lamare
» L'actualité selon Truman M.....
» La France en 2024
» Pakistan : une frontière au bord de la guerre
» Alien Romulus
» SUR LES TRACES DU TITANIC
» prénonitions , signes du destin : ils y croient !
» L'info dans le monde - 2024
» Les bâtisseurs de Stonehenge | Enquêtes archéologiques | ARTE
» RETOURNER SUR LA LUNE, ÇA SERT À RIEN (12parsecs)
» Les reclus de Monflanquin