Des l'apparition du livre de l'abbé Boudet, intitulé la Vraie Langue Celtique (Carcassonne. Pomiès, 1886, in-i2), nous signalâmes (1) la désinvolture fantaisiste avec laquelle l’auteur tranchait une très difficile question.

Un écrivain, dont l'appréciation a une portée non négligeable en pareille matière, vient d'exprimer son opinion plus durement que nous ne l'avions fait nous-mêmes. « Nous ne saurions trop engager les archéologues de l’Aude, dit M. Cartailhac , à se méfier des étymologies suggérées par un brave prêtre du pays, auteur d'une brochure inénarrable sur la Vraie Langue Celtique (2). »
IL est de fait que lorsqu'on voit l'abbé Boudet prendre l'étymologie de certains noms topographiques dans l'anglais actuel, et rattacher ces mots anglais à la langue celtique, on est forcé de dire qu'il ne connaît pas le premier mot de la question et qu'il n'a pas la moindre idée des progrès actuels de la science linguistique.
Les écrivains tels que Bopp. Pictet, Whitley-Slokes, Gluck, Zeuss, Nigra, d'Arbois de Jubainville, Gaidoz, dont les travaux ont commencé a débrouiller le chaos de la celtologie, n'existent point pour l'abbé Boudet. Il ne les connaît pas, il ne veut pas les connaître : du fond de ses montagnes la vérité lui est apparue. ..
Nous ne voulons pas nous attarder à discuter des étymologies dignes tout au plus de prendre place dans la collection du fameux Punch de Londres.
Nous ne pouvons cependant résister à la tentation d'en citer une ou deux en souvenir du moment de douce gaité qu'elles nous ont procuré. C'est de l'anglais que l'auteur de la Vraie Langue Celtique fait venir le nom illiberri (Elne), que tout le monde sait provenir de l'ibérien. C'est aussi de l'anglais que viendrait le nom de Lybiens (Iea . prairie, by, à travers). Quant à Nemausus (Nîmes), l'auteur le trouve dans name, nom , et house, maison, parce que dit-il, la Maison Carrée de Nîmes était une maison qui avait un nom, une maison renommée!
Cela suffit, n'est-ce pas î
Passons à la formule générale d'où dérivent ces prétendues étymologies..Cette formule est celle-ci :« Beaucoup de noms topographiques retrouvent leurs racines celtiques dans l'anglais actuel. »
Mais l'abbé Boudet ignore que l'anglais actuel n'a, avec la langue celtique, que des affinités très éloignées. L'anglais actuel est un idiome hybride dans la formation duquel le celtique n'entre que pour une part infinitésimale, ainsi que le montre le tableau suivant (3).
Total Teutonique.............. 13529 mots
Total romain................. 29748 mots
Total celtique et incertain...... 355 mots
Total général......... 43632 mots
Ainsi l'anglais actuel doit plus des deux tiers de ses mots aux langues classiques ; un tiers est teuton : quant au celtique, si l'on retranche les mots d'origine incertaine compris dans la catégorie où nous l'avons rangé, on voit qu'il entre pour une proportion si minime qu'elle est absolument négligeable. C'est donc une inconséquence manifeste de vouloir ériger en principe que des étymologies celtiques se retrouvent dans la langue anglaise de nos jours (4).
Mon illustre maître et ami, M. D'Arbois de Jubainville, qui professe avec tant d'éclat, au Collège de France, un cours de littérature celtique, a bien voulu me donner son opinion sur certaines étymologies celtiques que je lui soumettais relativement a plusieurs localités de l'Aude. Inutile de dire que je n'avais point pris ces étymologies dans le livre de l'abbé Boudet.
L'étymologie celtique des localités, me disait avec raison l'éminent professeur, ne peut se reconnaître qu'en examinant la physionomie de ces noms dans les chartes très anciennes. En dehors d'Eburo magus (Bram), dont la forme se retrouve en diverses régions et dont la décomposition celtique est classique, si je peux m'exprimer ainsi, M. D'Ar¬bois de Jubainville se montrait fort réservé sur d'autres étymologies dont j'indiquerai quelques-unes.
La Dure, petite rivière près Montolieu, citée souvent dans les chartes du IXème siècle, sous les noms de Duramnus, Durannus, Duranus, se rapprochant du mot gaulois Duranum (5).
Gaura, qu'un acte de 1344 appelle Gaurum, a une grande analogie avec Gaura mons (6) qui semble à M. Alfred Maury avoir une physionomie gauloise (7).
Le nom du Lauragais, mentionné dans les diplômes du XIème siècle sous les noms de Lauracensis ou Lauriacensis ager, ressemble à celui de la ville gauloise de Lauriac dans la Norique ( . De plus, le Lauragais, voisin de l’oppidum celtique de Vieille Toulouse, fut un des séjours préférés des Volkes Tectosages qui représentent l'élément gaulois de nos contrées. Nous y joindrons Laure (Lauranus). Mais avec moins de confiance, car on n'y retrouve que le préfixe Laur (laier en cornique, lar en vieil irlandais), tandis qu'on retrouve dans Laurac, petit village du Lauragais, La désinence gauloise latinisée acus (Lauracus).
. De plus, le Lauragais, voisin de l’oppidum celtique de Vieille Toulouse, fut un des séjours préférés des Volkes Tectosages qui représentent l'élément gaulois de nos contrées. Nous y joindrons Laure (Lauranus). Mais avec moins de confiance, car on n'y retrouve que le préfixe Laur (laier en cornique, lar en vieil irlandais), tandis qu'on retrouve dans Laurac, petit village du Lauragais, La désinence gauloise latinisée acus (Lauracus).
Mentionnons cette désinence dans Mailhac (Maglacus) où l'on retrouve aussi le nom d'homme gaulois Maglus (Maglus, fils de Conomaglus) .
Il y aurait à examiner aussi certaines étymologies de Littré. Par exemple : Bord qui signifierait planche en gaulois et dans laquelle on retrouverait l'origine des nombreuses Bordes de l'Aude : Borde Rouge (près Drousses). Bordeneuve (près Montirat), la Bourdasse (près Pradelles). —combe se trouverait aussi dans le celtique, suivant Littré (bas-breton et irlandais). Ce serait donc lui qui aurait fourni le nom du hameau de Lacombe, des Gambettes (près Saissac). M. Foncin trouve même l'étymologie de Comigne dans « ruisseau de la Combe. (9) »
Enfin le Kerkob, pays de Chalabre, apparaît dans un acte de 1002. C'est une des étymologies que nous citions avec le plus d'assurance à M. d'Arbois de Jubainville, parce qu'elle nous paraissait contenir le préfixe caer, qui signifie château, cité, en cambrique. Cependant l'éminent celtologue n'a pas voulu se prononcer (10).
Mous comprenons d'ailleurs fort bien la réserve de M. d'Arbois de Jubainville. L'élément gaulois pur n'a laissé que très peu de traces dans nos pays. Les Volkes n'y sont arrivés qu'en 250 environ avant notre ère ; or, moins de 150 ans plus tard, les Romains s'emparaient de cette région, qui fut la première romanisée et latinisée de toutes les provinces de la Gaule . La domination gauloise a été par conséquent très bornée sur les bords de l'Atax au point de vue de sa durée et de son influence.
Ce qui prouve combien il faut être circonspect chaque fois qu'on veut évoquer son souvenir en ce qui concerne la recherche des antiquités celtiques de l'Aude.
Notes
(1) Radical du Midi, 26 mai 1887.
(2) Emile de Cartailhac,Revue des Pyrénées, 1892, tome IV,p. 167,
(3) Drossé par Thommerel (Recherches sur l‘anglo-saxon, p. 91) d'après le dictionnaire de robertson contrôlé par les dictionnaires de Welister, Bosworlh et Meidinger.
(4) Gonf. Baret (Etude sur la langue anglaise au XIVème siècle). Paris, Cerf, 1883, in-8.
(5) Zeuss (Grammatica Celtica). Berolini, 1871, in-4, p. 772. ) Ancien nom du col de Cabres (Drome).
(6) A. Maury (Journal des savants), septembre 1878.— Revue Historique, ]uin 1881.
(7) Itinéraires, Ammien Marcellin.
( Zeuss (Grammatica celtica, 766.)
Zeuss (Grammatica celtica, 766.)
(9) Du Pago Carcassonensi.— Mais cette étymologie, qui vient plutôt du nom latin Cominius, est évidemment fausse.
(10| Remarquons en passant que beaucoup ont cru trouver l’étymologie de Carcassonne dans ce préfixe caer. Mais il est à peu près reconnu aujourd'hui que l'ancien Carcaso présente une physionomie phénicienne très accentuée. Desjardins (géographie de la Gaule romaine, l, 2-21).
Source
Société d'Etude Scientifique de l'Aude, Tome IV, 1893

Un écrivain, dont l'appréciation a une portée non négligeable en pareille matière, vient d'exprimer son opinion plus durement que nous ne l'avions fait nous-mêmes. « Nous ne saurions trop engager les archéologues de l’Aude, dit M. Cartailhac , à se méfier des étymologies suggérées par un brave prêtre du pays, auteur d'une brochure inénarrable sur la Vraie Langue Celtique (2). »
IL est de fait que lorsqu'on voit l'abbé Boudet prendre l'étymologie de certains noms topographiques dans l'anglais actuel, et rattacher ces mots anglais à la langue celtique, on est forcé de dire qu'il ne connaît pas le premier mot de la question et qu'il n'a pas la moindre idée des progrès actuels de la science linguistique.
Les écrivains tels que Bopp. Pictet, Whitley-Slokes, Gluck, Zeuss, Nigra, d'Arbois de Jubainville, Gaidoz, dont les travaux ont commencé a débrouiller le chaos de la celtologie, n'existent point pour l'abbé Boudet. Il ne les connaît pas, il ne veut pas les connaître : du fond de ses montagnes la vérité lui est apparue. ..
Nous ne voulons pas nous attarder à discuter des étymologies dignes tout au plus de prendre place dans la collection du fameux Punch de Londres.
Nous ne pouvons cependant résister à la tentation d'en citer une ou deux en souvenir du moment de douce gaité qu'elles nous ont procuré. C'est de l'anglais que l'auteur de la Vraie Langue Celtique fait venir le nom illiberri (Elne), que tout le monde sait provenir de l'ibérien. C'est aussi de l'anglais que viendrait le nom de Lybiens (Iea . prairie, by, à travers). Quant à Nemausus (Nîmes), l'auteur le trouve dans name, nom , et house, maison, parce que dit-il, la Maison Carrée de Nîmes était une maison qui avait un nom, une maison renommée!
Cela suffit, n'est-ce pas î
Passons à la formule générale d'où dérivent ces prétendues étymologies..Cette formule est celle-ci :« Beaucoup de noms topographiques retrouvent leurs racines celtiques dans l'anglais actuel. »
Mais l'abbé Boudet ignore que l'anglais actuel n'a, avec la langue celtique, que des affinités très éloignées. L'anglais actuel est un idiome hybride dans la formation duquel le celtique n'entre que pour une part infinitésimale, ainsi que le montre le tableau suivant (3).
Total Teutonique.............. 13529 mots
Total romain................. 29748 mots
Total celtique et incertain...... 355 mots
Total général......... 43632 mots
Ainsi l'anglais actuel doit plus des deux tiers de ses mots aux langues classiques ; un tiers est teuton : quant au celtique, si l'on retranche les mots d'origine incertaine compris dans la catégorie où nous l'avons rangé, on voit qu'il entre pour une proportion si minime qu'elle est absolument négligeable. C'est donc une inconséquence manifeste de vouloir ériger en principe que des étymologies celtiques se retrouvent dans la langue anglaise de nos jours (4).
Mon illustre maître et ami, M. D'Arbois de Jubainville, qui professe avec tant d'éclat, au Collège de France, un cours de littérature celtique, a bien voulu me donner son opinion sur certaines étymologies celtiques que je lui soumettais relativement a plusieurs localités de l'Aude. Inutile de dire que je n'avais point pris ces étymologies dans le livre de l'abbé Boudet.
L'étymologie celtique des localités, me disait avec raison l'éminent professeur, ne peut se reconnaître qu'en examinant la physionomie de ces noms dans les chartes très anciennes. En dehors d'Eburo magus (Bram), dont la forme se retrouve en diverses régions et dont la décomposition celtique est classique, si je peux m'exprimer ainsi, M. D'Ar¬bois de Jubainville se montrait fort réservé sur d'autres étymologies dont j'indiquerai quelques-unes.
La Dure, petite rivière près Montolieu, citée souvent dans les chartes du IXème siècle, sous les noms de Duramnus, Durannus, Duranus, se rapprochant du mot gaulois Duranum (5).
Gaura, qu'un acte de 1344 appelle Gaurum, a une grande analogie avec Gaura mons (6) qui semble à M. Alfred Maury avoir une physionomie gauloise (7).
Le nom du Lauragais, mentionné dans les diplômes du XIème siècle sous les noms de Lauracensis ou Lauriacensis ager, ressemble à celui de la ville gauloise de Lauriac dans la Norique (
Mentionnons cette désinence dans Mailhac (Maglacus) où l'on retrouve aussi le nom d'homme gaulois Maglus (Maglus, fils de Conomaglus) .
Il y aurait à examiner aussi certaines étymologies de Littré. Par exemple : Bord qui signifierait planche en gaulois et dans laquelle on retrouverait l'origine des nombreuses Bordes de l'Aude : Borde Rouge (près Drousses). Bordeneuve (près Montirat), la Bourdasse (près Pradelles). —combe se trouverait aussi dans le celtique, suivant Littré (bas-breton et irlandais). Ce serait donc lui qui aurait fourni le nom du hameau de Lacombe, des Gambettes (près Saissac). M. Foncin trouve même l'étymologie de Comigne dans « ruisseau de la Combe. (9) »
Enfin le Kerkob, pays de Chalabre, apparaît dans un acte de 1002. C'est une des étymologies que nous citions avec le plus d'assurance à M. d'Arbois de Jubainville, parce qu'elle nous paraissait contenir le préfixe caer, qui signifie château, cité, en cambrique. Cependant l'éminent celtologue n'a pas voulu se prononcer (10).
Mous comprenons d'ailleurs fort bien la réserve de M. d'Arbois de Jubainville. L'élément gaulois pur n'a laissé que très peu de traces dans nos pays. Les Volkes n'y sont arrivés qu'en 250 environ avant notre ère ; or, moins de 150 ans plus tard, les Romains s'emparaient de cette région, qui fut la première romanisée et latinisée de toutes les provinces de la Gaule . La domination gauloise a été par conséquent très bornée sur les bords de l'Atax au point de vue de sa durée et de son influence.
Ce qui prouve combien il faut être circonspect chaque fois qu'on veut évoquer son souvenir en ce qui concerne la recherche des antiquités celtiques de l'Aude.
Notes
(1) Radical du Midi, 26 mai 1887.
(2) Emile de Cartailhac,Revue des Pyrénées, 1892, tome IV,p. 167,
(3) Drossé par Thommerel (Recherches sur l‘anglo-saxon, p. 91) d'après le dictionnaire de robertson contrôlé par les dictionnaires de Welister, Bosworlh et Meidinger.
(4) Gonf. Baret (Etude sur la langue anglaise au XIVème siècle). Paris, Cerf, 1883, in-8.
(5) Zeuss (Grammatica Celtica). Berolini, 1871, in-4, p. 772. ) Ancien nom du col de Cabres (Drome).
(6) A. Maury (Journal des savants), septembre 1878.— Revue Historique, ]uin 1881.
(7) Itinéraires, Ammien Marcellin.
(
(9) Du Pago Carcassonensi.— Mais cette étymologie, qui vient plutôt du nom latin Cominius, est évidemment fausse.
(10| Remarquons en passant que beaucoup ont cru trouver l’étymologie de Carcassonne dans ce préfixe caer. Mais il est à peu près reconnu aujourd'hui que l'ancien Carcaso présente une physionomie phénicienne très accentuée. Desjardins (géographie de la Gaule romaine, l, 2-21).
Source
Société d'Etude Scientifique de l'Aude, Tome IV, 1893




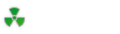
» Pourra-t-on un jour RENCONTRER des EXTRATERRESTRES ?
» Il promettait de rejoindre Dieu en vaisseau spatial
» ILS CAPTURENT DES CRÉATURES EXTRATERRESTRES AU BRÉSIL. (L'affaire Varginha)
» J' AVAIS TORT
» La France en 2024
» 20 ÎLES TOTALEMENT PERDUES
» Etrange lumière dans la mer , OANI ?
» La Maison des feuilles (livre)
» Fallout (la série)
» CROYEZ-VOUS EN DIEU ? Sondage de rue !
» Comment ce cirque caché une secte
» FOUR.COM : Ce Mystère d'internet
» 6 histoires TERRIFIANTES, SEUL DANS LA MER
» Sujet pour les fans de One piece